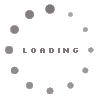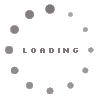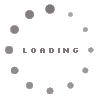Aerospatium.info utilise des cookies afin d'améliorer votre navigation. Vous pouvez choisir de ne pas les installer sur votre navigateur.
Si vous souhaitez plus d'information, rendez-vous sur la page dédiée à la politique de confidentialité
AccepterRefuser Politique de confidentialité